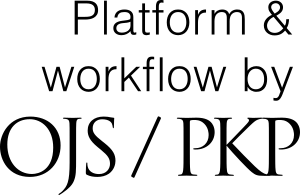Serviço Público de Média em Portugal e no Brasil
Problemas e desafios da pesquisa comparada
DOI:
https://doi.org/10.25200/SLJ.v6.n2.2017.317Palabras clave:
Comparaison, JournalismeResumen
Le développement des études de communication dans une logique d’internationalisation de la connaissance scientifique a favorisé l’essor des recherches comparatives. Le rapprochement du Portugal et du Brésil en termes académiques s’inscrit dans ce phénomène, et les études scientifiques qui cherchent à établir des parallèles entre les deux côtés de l’Atlantique sont déjà très nombreuses. D’un point de vue épistémologique, et malgré le partage d’une langue commune — le portugais — la recherche comparative représente un ensemble de défis théoriques et empiriques, impliquant une compréhension des contextes culturels et des traditions sociales et politiques. À partir d’un travail sur les médias de service public dans ces deux pays, cet article aborde les problèmes conceptuels et empiriques soulevés par l’utilisation de la méthode comparative. Que signifie comparer à des fins de recherche ? Pourquoi comparer ? Quelles sont les implications interculturelles de la recherche comparative ? Voici quelques-unes des questions auxquelles cet article vise à répondre. Du point de vue méthodologique, nous confrontons dans ce travail plusieurs désignations et concepts (comme les médias de service public et la communication publique) et exposons les racines culturelles et les divergences idiomatiques qui justifient des différences conceptuelles substantielles. Compte tenu des traditions dans lesquelles sont inscrits les deux pays — le Portugal dans une tradition européenne, marquée depuis longtemps par l’intervention de l’État dans l’industrie de la radio et la télévision ; le Brésil dans une tradition américaine, plus libérale, où la radio et la télévision se sont développées plus à l’initiative du privé que de l’État — nous cherchons à comprendre historiquement l’origine et la pertinence des systèmes de communication publique. Sur la base d’entrevues avec des intervenants clés d’entreprises publiques des deux pays, nous concluons que les différentes étapes de développement et, en même temps, les différentes priorités d’action constituent un obstacle à la définition de catégories de comparaison, mais aussi une occasion de construire une équivalence, à la fois culturelle et scientifique.